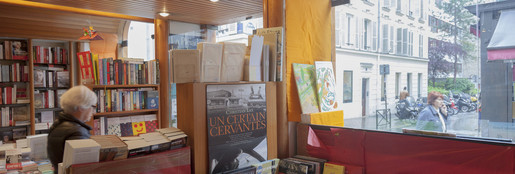
Défendre la politique publique en faveur du livre et de la lecture
Le SLF réagit à la publication du rapport du Sénateur Jean-Raymond Hugonet intitulé « L’aide de l’Etat au secteur du livre : un soutien efficace ».
Une reconnaissance de l’efficacité, de la cohérence et du faible impact budgétaire de la politique de l’Etat en faveur du livre
Le SLF se félicite de la confirmation par le rapport du Sénateur Jean-Raymond Hugonet, de l’efficacité, de la cohérence et de l’impact financier limité des aides publiques à la filière du livre. Hors incidence du taux réduit de TVA, ces aides sont estimées à 50,7 millions d’euros, dont 28,5 millions d’euros pour le Centre national du livre (CNL), soit 6,8% seulement des crédits publics consacrés au livre et à la lecture au niveau national. Le livre apparait ainsi comme le secteur des industries culturelles le moins aidé alors qu’il est celui qui pèse le plus en termes de chiffre d’affaires (le taux d’intervention publique dans la filière du livre est ainsi de 0,23%).
Le rapport de Jean-Raymond Hugonet considère que les aides directes à la filière du livre, principalement celles du CNL et des DRAC, sont efficaces et bien ciblées malgré des montants limités. Il salue la bonne articulation entre les différents opérateurs publics et privés (CNL, DRAC, Régions, ADELC, IFCIC…
Des critiques inquiétantes et largement infondées aux yeux du SLF
Malgré cette évaluation globalement très positive de la politique publique en faveur du livre et de la lecture, le rapport Hugonet comporte des analyses ou des prises de position inquiétantes et, aux yeux du SLF, largement infondées sur plusieurs sujets majeurs : les aides aux librairies durant la crise sanitaire, le taux réduit de TVA, les prêts aux entreprises du CNL ou encore le pass Culture.
Une présentation biaisée de la situation des librairies durant la crise sanitaire
Quand le rapport évoque une « sur-rentabilité des librairies durant la crise sanitaire », le SLF tient à rappeler les réalités qui ont conduit à la mise en place de dispositifs d’aide temporaires exceptionnels.
En mars 2020, la fermeture administrative imposée à toutes les librairies françaises menaçait la survie de plus de la moitié d’entre elles, leur trésorerie ne leur permettant pas de tenir au-delà de quatre ou cinq semaines. Face à ce risque, le dispositif construit avec les ministères de la Culture et de l’Economie ainsi qu’avec le CNL a visé à couvrir les charges fixes des librairies, autrement dit à neutraliser l’effet du premier confinement sur leur exploitation.
Lors du deuxième confinement, alors que seuls les achats de livres par internet étaient possibles, l’Etat a pris en charge les frais d’expédition de livres engagés par les librairies afin de les mettre dans une position de concurrence équitable face à Amazon qui imposait le standard de la livraison gratuite. Sans ces deux dispositifs, de nombreuses librairies n’auraient pas passé le cap de la crise sanitaire. La mobilisation des lecteurs en faveur des librairies lors des déconfinements n’était en aucun cas prévisible et ne retire rien à la pertinence des dispositifs financiers mis en place.
Une position ambiguë sur le taux réduit de TVA
Le rapport sénatorial semble dénoncer le fait que le taux réduit de TVA bénéficie prioritairement aux personnes ayant les revenus les plus élevés. Il en déduit que « le taux de 5,5% applicable au livre ne constitue pas un instrument pertinent en termes de redistribution ». Le SLF ne partage pas cette vision qui ne mesure pas l’effet qu’un relèvement du taux de TVA aurait, à l’inverse, sur la démocratisation de l’accès au livre et à la lecture. Les contraintes croissantes en matière de pouvoir d’achat se font d’ores et déjà durement ressentir chez de nombreux clients qui espacent leurs achats ou renoncent à fréquenter leur librairie. Rappelons par ailleurs que la quasi-totalité des pays européens appliquent un taux réduit de TVA pour le livre et même, pour plusieurs d’entre eux, l’exemptent totalement de TVA (Royaume-Uni, Norvège, Irlande, République tchèque).
Une remise en cause des prêts économiques du CNL
Alors que le rapport Hugonet loue l’efficacité de l’action du CNL, il est très surprenant de voir inscrite dans ses recommandations la suppression de l’octroi de prêts par cet établissement public, au profit de subventions, et d’un recours accru à l’IFCIC pour les emprunts. Le SLF ne partage nullement cette recommandation car le CNL est un établissement public chargé de la mise en œuvre d’une politique publique alors que l’IFCIC, quels que soient ses mérites, est un établissement bancaire. Par ailleurs, les prêts sont par définition remboursables et le rapport souligne lui-même le très faible niveau de sinistralité, proche de zéro. Des prêts efficaces et remboursés, n’est-ce pas de l’argent public bien utilisé ?
Un acharnement regrettable contre le pass Culture
Le SLF dénonce l’acharnement contre le pass Culture, présenté comme « une aide d’Etat massive » destinée à subventionner indirectement la filière du livre. Il apparait à cet égard indispensable de rappeler quelques vérités simples :
- Ce sont les jeunes qui plébiscitent le livre et la lecture ce qui constitue une formidable nouvelle au moment où l’on déplore un effondrement global de la lecture.
- Grâce au pass, les jeunes découvrent une multiplicité de livres et pas seulement des mangas et de la romance, ces genres ne représentant que 30% de leurs achats en librairie.
- Le pass est un dispositif populaire qui bénéficie à 68% des jeunes issus des classes populaires, soit une performance très supérieure à bien d’autres pratiques culturelles.
- Enfin, le pass Culture crée des habitudes qui, pour une bonne part, perdurent au-delà de l’utilisation du crédit.
Le SLF considère qu’il faut capitaliser sur le succès du pass Culture pour l’accès au livre et à la lecture et le considérer comme un investissement.
A la veille de débats budgétaires qui s’annoncent complexes, le SLF appelle le gouvernement et l’ensemble des parlementaires à retenir du rapport de Jean-Raymond Hugonet que la filière du livre fait un usage raisonné et très ciblé de la dépense publique. Peu d’aides mais des aides efficaces. Il est impératif de ne pas remettre en cause ce modèle, certes modeste mais déterminant et fragile.